Le tamarinier (Tamarindus indica L., Caesalpiniaceae) est une plante aux multiples propriétés dont presque chaque partie, de la racine aux feuilles, peut être utile aux besoins humains. Des applications industrielles ont été développées dans les domaines alimentaire, chimique, pharmaceutique et textile. A côté de cela, les parties non comestibles sont aussi employées comme fourrage, bois de chauffage ou encore carburant. Du fait de sa richesse en nutriments, le tamarinier joue un rôle important dans la nutrition humaine, principalement dans les pays en développement où une large part de la population et des animaux souffre de malnutrition protéique. Dans les pays où l’arbre pousse naturellement, la saveur acide de la pulpe du fruit en fait un ingrédient prisé pour diverses préparation culinaires, telles que currys, chutneys, sauces, glaces et sorbets. Du fait de ses propriétés phytochimiques, différentes parties ou extraits de T. indica sont utilisés soit directement soit sous forme de préparations en médecine traditionnelle.
Origine de la plante
Le tamarinier est l’une des espèces d’arbres fruitiers tropicaux les plus répandues du sous-continent indien. Son nom, issu du persan « Tamar-I-hind », littéralement datte d’Inde, renvoie à une origine d’abord supposée indienne. Cependant, la présence du tamarinier sur le continent africain est aujourd’hui admise comme antérieure à son implantation en Asie. Le tamarinier est largement présent dans les régions d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh), dans certaines parties de l’Afrique (Soudan, Nigeria, Madagascar, Mali, Burkina Faso) et dans la plupart des pays tropicaux (Antilles) où il est couramment cultivé comme arbre ornemental et utilisé pour fabriquer des boissons et des décoctions utilisées en médecine traditionnelle. Contrairement aux produits pharmaceutiques, il est souvent gratuit et facilement disponible. La transmission de génération en génération de l’usage thérapeutique de la plante répond, ici, toujours à ce principe de gratuité du savoir développé par l’homme et de l’usage de ce que la nature peut offrir.
Description et morphologie
Le tamarinier est décrit comme un arbre au bois dur, au feuillage persistant et atteignant jusqu’à 24 m de hauteur et 7 m de circonférence. Les feuilles alternent, composées de 10 à 18 paires de folioles (divisions de la feuille) opposées, étroitement oblongues et recouvertes d’un fin duvet. Les fleurs attrayantes, jaune pâle ou rosâtre, sont disposées en petites pointes relâchées d’environ 2,5 cm de largeur. Le fruit, une gousse indéhiscente (qui reste fermée et se détache toute entière de l’arbre), forme un cylindre de 10-18 × 4 cm, droit ou incurvé, d’aspect velouté et de couleur brun rouille. La gousse est cassante et contient des graines dures et luisantes incrustées dans une pulpe comestible, de consistance pâteuse et de couleur brun rougeâtre et dont l’odeur est aromatique, la saveur acidulée.
Activité médicinale et pharmacologique
En France, si l’Agence du médicament reconnaît l’absence de cytotoxicité du tamarin, elle en reconnaît un usage assez limité, notamment comme laxatif dans le traitement symptomatique de la constipation pour la pulpe de fruit de tamarin ou comme antalgique dans le traitement symptomatique des douleurs liées à la poussée dentaire pour l’extrait aqueux mou de pulpe de tamarin.
Des chercheurs du Département de pharmacologie de l’Institut Shri Ram de Jabalpur en Inde ont procédé à une revue de la littérature recensant environ une centaine d’études, à la fois in vitro et sur des modèles animaux, portant sur l’activité pharmacologique des différentes parties de Tamarindus indica. Nous présentons ci-dessous une synthèse de leur article.
Activité antibactérienne à large spectre. Les six études recensées, à la fois in vitro et sur des modèles animaux, avaient pour objet une meilleure compréhension de l’activité antibactérienne de différents extraits de T. indica. Par exemple, l’extrait de feuille de T. indica a été évalué pour son potentiel inhibiteur de Burkholderia pseudomallei, la bactérie responsable de la mélioïdose, une infection bactérienne tropicale. L’extrait deT. indica par deux procédés différents a montré une activité antimicrobienne importante contre Klebsiella pneumoniae, une bactérie opportuniste à l’origine d’infections nosocomiales. Des extraits concentrés par différents procédés ont montré une puissante activité antimicrobienne contre Salmonella paratyphi, Bacillus subtilis, Salmonella typhi et Staphylococcus aureus.
Propriétés antioxydantes. Les graines et le péricarpe (l’enveloppe protectrice de la graine) de T. indica contiennent un composé antioxydant phénolique qui lui confère des propriétés antioxydantes. Par son activité antioxydante, l’extrait de T. indica est ici décrit comme une source importante de chimio-prévention contre le cancer. L’extrait éthanolique de pulpe de fruit de T. indica a aussi montré une activité antioxydante et hypolipidémiante importante chez les cobayes hypercholestérolémiques.
Propriétés laxatives et antispasmodiques. Le fruit du T. indica est traditionnellement utilisé comme laxatif, en raison de la présence de grandes quantités d’acides maliques et tartriques et d’acide de potassium. En Afrique de l’Ouest, les feuilles et l’écorce fraîche macérée des jeunes rameaux est utilisée à la fois comme purgatif et pour soulager les douleurs abdominales. L’utilisation des racines préparées sous forme d’extrait, dans le traitement des maux d’estomac ou de l’abdomen douloureux, est principalement rapportée en Afrique de l’Est.
Cicatrisation des plaies. Les coupures, plaies et abcès sont le plus couramment traités avec l’écorce ou les feuilles de T. indica appliquées directement à l’endroit concerné sous différentes formes (décoction, poudre ou cataplasme), seul ou en combinaison avec d’autres espèces. La décoction de feuilles de T. indica est l’un des agents les plus importants pour nettoyer les plaies causées par les infections par le ver de Guinée.
Activité fébrifuge et antipaludique. Différentes parties de T. indica sont utilisées comme fébrifuge, la pulpe du fruit à Madagascar et les feuilles au Ghana pour traiter le paludisme.
Activité antidiabétique. L’extrait aqueux de graines de T. indica a été administré à des rats diabétiques légers et diabétiques sévères, et l’hyperglycémie a été considérablement réduite, mesurée par la glycémie à jeun. A cet égard, l’équipe du Département de pharmacologie de l’Institut médical Saveetha de Tamil Nadu en Inde a testé in vitro l’effet hypoglycémiant postprandial de l’extrait de pulpe de fruit de T. indica, ce qui n’avait pas encore été fait auparavant. L’extrait de pulpe de fruit de T. indica s’est avéré être un agent antidiabétique tout à fait comparable aux inhibiteurs du métabolisme des glucides couramment prescrits pour le contrôle de l’hyperglycémie postprandiale.
Prévention de l’athérosclérose. Chez des cobayes hypercholestérolémiques, l’effet de l’extrait brut de pulpe de fruit de T. indica a été étudié sur les taux sériques lipidiques et les lésions athéromateuses. L’étude souligne le potentiel élevé de l’extrait de tamarin pour diminuer le risque d’athérosclérose chez l’homme. Une autre étude expérimentale sur des cobayes a montré que l’extrait hydroalcoolique de pulpe de tamarin a influencé le système de médiation de l’inflammation.
Activité antivenimeuse. Dans la médecine traditionnelle indienne, diverses plantes ont été largement utilisées comme remède contre la morsure du serpent. L’une des deux études révèle notamment que l’extrait de T. indica a neutralisé la dégradation de la chaîne β du fibrinogène humain et l’hémolyse indirecte causée par le venin. L’extrait a prolongé modérément le temps de coagulation et les effets myotoxiques induits par le venin, tels que l’œdème et l’hémorragie, qui ont été neutralisés de manière significative lorsque différentes doses de l’extrait ont été administrées. L’extrait de T. indica est donc une alternative à la thérapie sérique.
Activité antihistaminique et hépato-protectrice. L’extrait de feuilles de T. indica a montré une activité antihistaminique, adaptogène et stabilisatrice des mastocytes importante chez les animaux de laboratoire testés. L’effet hépato-protecteur de T. indica a été évalué après injection au rat de paracétamol. Selon les paramètres étudiés, un effet hépato-régénératif significatif a été observé après administration de l’extrait aqueux de différentes parties de T. indica, notamment feuilles, fruits et graines non torréfiées.
Activité analgésique et anti-inflammatoire. L’écorce de T. indica est traditionnellement utilisée dans le traitement de la douleur. L’étude présentée fait ressortir que les animaux auxquels avait été administré l’extrait d’écorce de T. indica par éther de pétrole montraient une augmentation significative du temps de réaction à la douleur par rapport aux animaux ayant reçu des extraits par d’autres procédés. Les stérols et triterpènes présents dans l’extrait pourraient être responsables de l’activité analgésique observée. Enfin est encore rapportée l’utilisation du jus des feuilles associé au gingembre dans le traitement de la bronchite (Côte d’Ivoire, Haute-Volta) et de l’écorce séchée et pilée ajoutée à de l’eau pour le traitement des inflammations oculaires (Ghana).
Conclusion
Le tamarinier recèle ainsi une sagesse infinie qui fascine encore aujourd’hui, comme en témoigne le foisonnement d’études menées pour tenter d’en percer les secrets. D’un certain point de vue, l’arbre semble s’être donné à l’homme pour l’abriter, le soigner et le nourrir, ou plus exactement nourrir son corps et sa psyché. De là, il n’est pas étonnant qu’il soit déjà cité mille ans avant J.-C. dans les Écritures indiennes Brahma Samhita et qu’il suscite autant de dévotion. Nous invitons le lecteur à s’inspirer lui aussi de la sagesse de T. indica, surtout s’il souhaite s’engager dans une démarche de perte de poids. Comme chacun sait, il n’y a pas de solution simple à l’excès de poids qu’il faut, par conséquent, comprendre comme le symptôme d’un déséquilibre bien plus vaste qu’un simple déséquilibre alimentaire. Il s’agit d’un aspect important sur lequel nous aurons l’occasion de revenir dans les prochains articles du blog.
Références
Bruneton, J., 2009. Pharmacognosie : Phytochimie, plantes médicinales (4e éd. revue et augmentée). Cachan : Lavoisier.
Nivesh Krishna, R., Anitha, R., & Ezhilarasan, D., 2020. Aqueous extract of Tamarindus indica fruit pulp exhibits antihyperglycaemic activity. Avicenna Journal of Phytomedicine, 10(5), pp. 440-447. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32995322/.
Santosh Singh, B., Aditya, G., Jitendra N., Gopal R., & Alok Pal, J., 2011. Tamarindus indica: Extent of explored potential. Pharmacognosy Reviews, 5(9), pp. 73-81. https://dx.doi.org/10.4103/0973-7847.79102.
https://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0130167.htm.

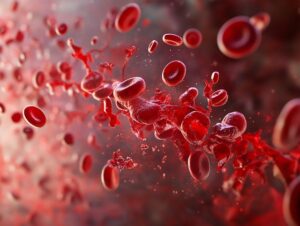
Laisser un commentaire